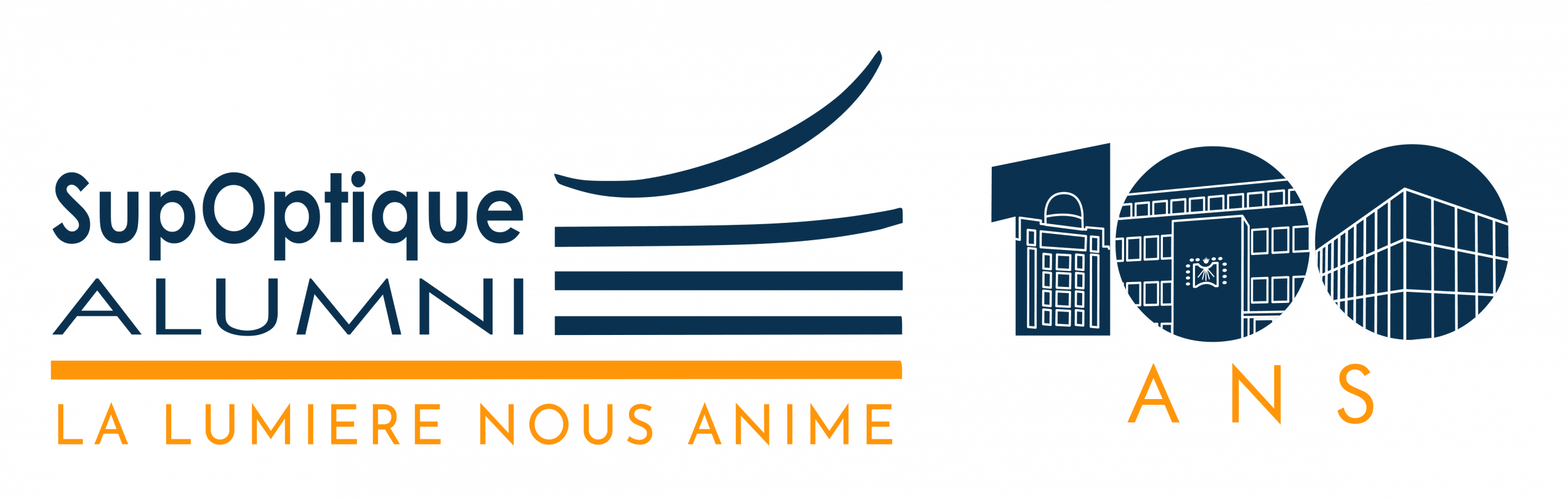"De l'interférométrie à l'imprévu : mon parcours entre sciences et stand-up !" par Célia PELLUET (promo 2020)
« Je m’appelle Célia et, quand je ne suis pas sur scène à faire des blagues, je travaille dans l’aérospatial. Je suis un peu en grand écart façon Van Damme entre deux mondes… »
Ces quelques mots, c’est ma présentation dans les comedy clubs, ces soirées d’humour nichées au fond des bars où, plusieurs fois par semaine, je tente de faire rire le public avec des histoires personnelles ou des anecdotes de mes années de thèse. Assez absurde, il me semble : si j’avais imaginé, en 2020, au moment où on me remettait le diplôme de l’IOGS, qu’une succession de choix – et surtout de non-choix – m’amènerait à être docteure en physique quantique le jour et humoriste le soir, je me serais dit que c’était une bonne blague.
From l'Ain to SupOp
Pour décrire mon parcours – il me semble que c’est le principe de ce témoignage ? – j’ai grandi dans le merveilleux département de l’Ain, premier de France dont la fierté principale repose sur l’ordre alphabétique. Entre les montagnes et les fromages odorants, j’ai vécu une enfance paisible, rythmée par l’apprentissage du chant et un intérêt pour les étoiles que j’avais la chance d’observer depuis la fenêtre de ma chambre (prenez ça, les Parisiens). La Barbie qui m’enseignait quotidiennement les diktats patriarcaux portait une blouse sur ses talons aiguilles et avait des photos de nébuleuses sur ses murs de plastique roses.
J’ai quitté mon village en seconde par le TER, direction la grande ville, pour aller en internat au Lycée du Parc à Lyon, où j’ai passé mes années de lycée et de prépa, dans les pas de prestigieux prédécesseurs tels que Christophe Barbier et Nathalie Arthaud (comme quoi, on ne devait pas être si formatés). Ma professeure de physique de lycée, Mme Marteau, avait confirmé mon intérêt pour la recherche en physique : elle invitait des chercheurs à faire des séminaires le soir après les cours, m’a offert la possibilité de faire un premier stage en seconde à l’Institut de Physique Nucléaire de Lyon… Un privilège dont j’ai bien conscience, dans un lycée privilégié à de nombreux égards, malgré une cantine tout bonnement abjecte – j’imagine que certain·e·s lecteur·ice·s de ce témoignage auront vécu une expérience similaire. Les salsifis cuits à l’eau n’entrant pas dans le périmètre de ce texte, laissons-les dans leur plat en inox.
Malgré les jugements élitistes de certains professeurs ou camarades de classe, je m’intéressais à une certaine école d’optique où l’on m’apprendrait “à faire des lunettes, gnagnagna”. Loin de pouvoir prétendre à une Normale Sup, je voyais en SupOptique l’opportunité d’étudier la physique, ce que démontrait la liste des cours qui contenait même ce mot que j’avais encore peu rencontré : “quantique”. Intriguant, ce mot, non ? Souvent, je l’entendais dans les films pour noyer de mauvais scénarios ou donner une crédibilité intellectuelle à un personnage. Qu’est-ce qu’il cachait ? Il me semblait alors que ce n’était pas dans une Centrale ou une Mine que je le découvrirais (allez, ça fait toujours plaisir de tailler les Mines).
Entre les grues et les photons
La suite, vous l’avez sûrement vécue aussi : l’arrivée sous une brume grisâtre sur le plateau de Saclay où fleurissaient alors les grues. Et les sourires accueillants des 2A qui nous tendent un t-shirt de couleur, les soirées à danser sur le bar, les associations qui m’ont tant apporté au prix de mes heures de sommeil et d’un nombre incalculable de crêpes. Les cours passionnants, ceux qui l’étaient moins, la découverte des labos, des sites de Bordeaux et Saint-Étienne. La photonique, bien sûr, qui serait au XXIe siècle ce que… vous l’avez. C’est lors d’un TP à la fac d’Orsay, entre 18h et 22h, que j’apprenais la défaite de la liste BDE dont j’étais la trésorière, les Super Heriogs. Les hyperfréquences ont eu du mal à me distraire de la déception – on avait quand même organisé la Fête du Slip !
Après une première année riche en émotions, mais moins en bonnes notes (je dois bien l’admettre), nous partons, avec dix autres de ma promo, pour une mission humanitaire au Népal. Un mois passé à peindre une fresque dans un orphelinat et à préparer, avec des bambous et du matériel approximatif, des expériences de physique pour les enfants (petite pensée pour la lunette astronomique à focale réglable, faite de lentilles aberrantes, d’un tube de bambou et de scotch).

Le déchirement de la promotion avec nos amis partis à Bordeaux n’a pas eu raison de mon intérêt pour les photons, et cette année a été faite de physique statistique et de comptes rendus de TP. Mais aussi d’un événement : le Campus Comedy Tour. En tant que membre du BDA, je devais organiser la venue de ce concours étudiant pour une édition SupOptique/ENSTA. Il s’agissait tout bonnement de trouver “l’étudiant le plus drôle de France”, en faisant venir dans nos écoles des humoristes confirmés. La première partie du show était assurée par les étudiants des écoles, qui devaient préparer un sketch pour participer à la sélection. La date approchait, et après avoir sondé les étudiants qui, pourtant, auraient dû chercher la lumière, personne ne s’était inscrit. Il fallait sauver l’honneur : on n’allait quand même pas venir bredouilles devant l’amphi de l’ENSTA, sans même tenter quelques blagues pour être représentés dans ce concours.
C’est alors que, quelques appels Palaiseau-Bordeaux plus tard, mon ami Baptiste Cerisier (promo 2019, alias “Ceryse” sur la scène musicale) et moi avons décidé de préparer une chanson humoristique. Et c’est sur une reprise de Manhattan-Kaboul que nous avons fait notre première scène d’humour, dont la vidéo nous a permis d’être sélectionnés pour la finale. À peine croyable : la grande finale, sur la scène de la Cigale à Paris, un gala d’humour avec les cinq étudiants finalistes et des humoristes comme Tania Dutel, Baptiste Lecaplain ou Roman Frayssinet. On joue, tout se passe très bien, le public rit, les résultats sont annoncés… C’est la défaite. Une défaite parfaitement attendue, cela dit, puisque l’étudiant le plus drôle de France cette année-là n’était autre que Paul Mirabel.
Je termine cette deuxième année par un stage chez Imagine Optic sous la supervision de Guillaume Dovillaire (promo 1996), pendant lequel je travaille sur un banc d’optique adaptative pour des “petits” télescopes. Le stage est couronné de trois belles nuits de tests du système sur un télescope de l’observatoire du Pic du Midi, et je découvre l’un des plus beaux ciels étoilés qu’il m’ait été donné de voir.
Césure : sois stage et amuse-toi
J’avais décidé de faire une “pause” dans mes études SupOpticiennes pour trancher mon dilemme cornélien entre l’envie de faire un master en instrumentation pour l’astronomie ou en physique quantique expérimentale. J’ai donc pris une année de césure pour faire des stages dans les deux domaines.
Je suis arrivée en octobre 2018 au Centre National d’Études Spatiales pour un stage de cinq mois au service optique, sous la supervision de Thomas Leveque (promo 2007), alumni de l’École. Thomas m’a fait découvrir le domaine des atomes froids, qu’il avait étudié en thèse à l’Observatoire de Paris, et m’a fait travailler sur un lien laser à interférométrie hétérodyne pour la mesure de distance inter-satellites. Je m’amuse alors avec mon premier laser stabilisé en fréquence par absorption saturée sur le rubidium, évoluant dans l’agence spatiale française qui me faisait rêver depuis plusieurs années. Avec une excellente cantine, qui plus est. Au détour d’une discussion, Thomas me suggère l’idée de faire une thèse au laboratoire de l’Institut d’Optique à Bordeaux, le LP2N. Il me parle des travaux de Baptiste Battelier (promo 2003), qui transporte ce type d’expérience à bord de l’avion zéro G pour les tester en impesanteur. Lors d’un passage à Bordeaux, je rencontre Baptiste et visite son laboratoire. C’est donc deux ans avant de débuter que je savais déjà quel serait mon doctorat.
En février, je décolle pour mon deuxième stage de césure : je pars dans le désert d’Atacama, au Chili, pour travailler sur l’interféromètre stellaire du Very Large Telescope. Le sujet du stage consiste à trouver des solutions pour allonger la course des lignes à retard, qui servent à égaliser les chemins optiques entre les télescopes, afin d’avoir accès à une plus grande couverture du ciel. Pendant ces mois en Amérique du Sud, j’admire le ciel de cet hémisphère, je dors dans l’hôtel qui a servi de décor à un James Bond, et je croise Alain Aspect*, alors en visite sur place. J’étudie la faisabilité d’ajouter un périscope dans le système optique pour faire passer deux fois la lumière dans les lignes à retard, et j’ai même l’opportunité de tester la solution expérimentalement sur l’un des quatre bras, lors d’une nuit d’observation. Aujourd’hui, la solution a été appliquée aux quatre bras et est utilisée toutes les nuits sur ces télescopes parmi les plus grands du monde.
 Les atomes froids sous le soleil aquitain
Les atomes froids sous le soleil aquitain
La beauté de la Voie lactée ne m’a pas détournée de mon intérêt pour l’infiniment petit, et je reviens de ma césure pour suivre le master Light & Matter Interaction à Bordeaux, bien décidée à rester en thèse à l’Institut d’Optique d’Aquitaine. Le master est taillé pour me préparer à travailler dans un laboratoire d’atomes froids : cours d’interaction lumière-matière, TP sur une expérience d’atomes froids (ou plutôt, au moment où j’ai fait le projet, d’atomes à refroidir). Je fais mon stage de fin d’études sur l’expérience ICE : Interférométrie à source Cohérente pour l’Espace, dirigée par Baptiste Battelier. Je prends mes marques malgré les trois mois passés confinée.
En octobre 2020, je débute ma thèse sur l’interférométrie atomique à sources ultra-froides pour tester le principe d’équivalence depuis l’espace. Pour faire court – parce que ce témoignage est déjà bien trop long –, on utilise des nuages d’atomes refroidis par laser pour tester l’universalité de la chute libre. L’expérience ICE est une sorte de démonstrateur pour de futures missions spatiales. L’un des défis majeurs consiste à tester les phénomènes de refroidissement et les mesures d’accélération par interférences quantiques en l’absence de gravité, quand les atomes ne chutent plus par rapport aux lasers.
On a accès à deux plateformes de test pour ces expériences : l’avion zéro G et un simulateur situé dans notre laboratoire. Ce simulateur est une plateforme d’environ un mètre carré, mise en mouvement parabolique vertical sur environ deux mètres de hauteur, pour reproduire une trajectoire de chute libre. D’une certaine manière, on place notre expérience de plus de 200 kg sur un plateau qu’on lance en l’air… et qu’on rattrape. Ce simulateur nous donne accès à une demi-seconde de microgravité toutes les 13 secondes.

L’avion zéro G est une solution un peu plus encombrante pour accéder à l’impesanteur. C’est un avion commercial opéré par la société Novespace, qui effectue des paraboles dans le ciel pour offrir 22 secondes de microgravité aux expériences et aux scientifiques à bord. Le tout, au prix de niveaux de vibrations bien plus élevés, ainsi que d’une possible nausée. Au cours de ma thèse, j’ai eu la chance de participer à trois campagnes de vol zéro G, et de vivre 186 fois la sensation incomparable de ne pas sentir son poids pendant 22 secondes… tout en ayant une incomparable envie de vomir.

Dualité scène - laboratoire
Pendant cette thèse, seulement deux mois après mon premier vol zéro G, j’ai eu l’idée saugrenue de monter seule sur scène avec ma guitare pour faire rire un public. C’est en 2022 que j’ai donc commencé à écrire et jouer des textes, parfois plusieurs fois par semaine, dans les bars et salles de théâtre bordelais. Ainsi a débuté ma double vie étrange. J’aurais aimé avoir une double vie de super-héroïne, j’imagine, devenir une justicière nocturne, mais à la place, je chantais des blagues parfois impertinentes sur le flexitarisme ou Thomas Pesquet. Le jour, je testais des configurations d’interférométrie atomique ; le soir, je testais des blagues.

C’est probablement cette double casquette – doctorante en physique quantique et humoriste – qui a attiré l’attention de France Inter, qui m’invite en octobre 2023 à participer au tremplin du Grand Dimanche Soir. J’annonce alors, en direct à la radio nationale et devant un public de 1000 personnes à Bordeaux, que je viens de finir de rédiger ma thèse. Je reçois une salve d’applaudissements qui me paraît presque indécente : je la partage avec toutes les personnes qui sont allées au bout de cet exercice de longue haleine. Soyons honnêtes : ça fait du bien.
Je soutiens ma thèse en novembre 2023 et débute un post-doctorat en janvier 2024 sur la même expérience, pour travailler cette fois-ci sur une mission spatiale en cours d’étude : CARIOQA. Cette mission est une démonstration technologique de l’interférométrie atomique dans l’espace, afin de préparer les prochaines grandes missions scientifiques : étudier le champ de gravité depuis l’espace avec des atomes, par exemple, pour fournir des cartes de gravité plus précises aux géologues et climatologues qui les utilisent.
Je postule ensuite au CNES, qui cherche à embaucher un·e nouvel·le ingénieur·e en optique pour travailler sur cette mission spatiale, dans le service même où j’avais fait mon stage cinq ans auparavant.
C’est ce poste que j’occupe joyeusement depuis septembre 2024, menant en parallèle ma vie d’humoriste. Je prépare un spectacle d’humour musical et scientifique, qui verra (peut-être) le jour, et j’ai la chance d’intervenir de temps en temps dans l’émission de Guillaume Meurice La Dernière, en tant que vulgarisatrice et humoriste.
C’est un témoignage assez improbable d’une ancienne SupOp que je vous livre ici. À la fois très ancré dans la tradition de l’école, avec un parcours “très SupOp” (#interférométrie #passionfranges), et en même temps, avec un pan inattendu sur des scènes de stand-up. Inattendu, vraiment ? Quand on voit la double, triple, voire quadruple vie qu’on mène pendant nos années à l’école – entre BDE, sport, associations… – on passe d’un show pom-pom à un TP de conception optique en un clin d’œil, de l’organisation d’une soirée BDE à la révision d’un partiel d’holographie.
Alors peut-être que la vie que je mène, c’est celle de quelqu’un qui n’a jamais vraiment quitté SupOp.
On me demande souvent si je vais devoir choisir entre les carrières scientifiques et artistiques. Ce sont deux métiers-passion, et les mener en parallèle soulève quelques défis. Aujourd’hui, je ne me vois pas arrêter.
Célia
*Prix Nobel de Physique 2022
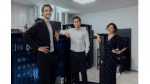
Commentaires0
Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.
Articles suggérés